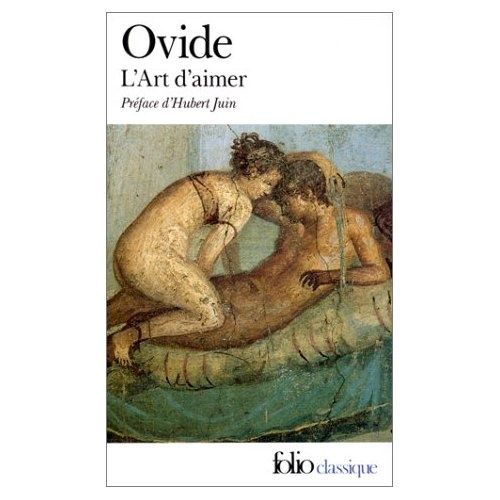L´ esquisse d´inventaire qui suit est un triple hommage : à Georges Perec d´abord; à Georges Lapassade ensuite; à René Barbier enfin.
C´est autant une Tentative d´épuisement d´un lieu parisien qu´un élément d´une ethnologie du quotidien ...
' ' '

Date : Lundi 04 Août 2008.
Heure : 13 h 30.
Lieu d´observation : la terrasse couverte du Burns Café d´Oslo ( = Le Burns Pub ), à l´angle de la rue du Parlement ( = Stortingsgate ) et de la rue Olav V ( = Olav´s V gate ).
"Objets" observés : les gens qui passent, dans leur totale diversité.
Temps : incertain et orageux.
' ' '
Ce lieu est un espace mal défini. Il est situé entre deux immeubles qui sont face à face et qui abritent ce que l´on peut considérer deux vraies institutions ou presque : le Burns Pub d´Oslo et une des centaines de boutiques Narvesen, spécialisées dans la vente de journaux, magazines et autres best-sellers norvégiens et anglais; sans parler des milliers de paquets de cigarettes de marques du monde entier.
Cet espace mal défini est cependant loin d´être neutre : il est un lieu de passage incessant où jamais la vie ne s´arrête, même aux heures les plus creuses de la nuit. Lieu de rencontres improbables, il est pourtant lieu d´une interculturalité exemplaire.
Les passants qui y passent et le traversent de droite à gauche, en diagonales ou de gauche à droite sont de toutes nationalités, de toutes conditions et de tous âges. Qu´ils le traversent d´un pas décidé ou d´un pas hésitant, une canne ou un plan à la main, ils l´animent d´une vie qui n´est désordonnée qu´en apparence. Ils savent où ils vont ( à défaut d´avoir sur les lèvres le nom du lieu où ils sont ) : le métro d´Oslo presque juste en face, ou la rue Karl Johan, principale artère de la ville à droite; la route de Drammen qui longe le Château du Roi à gauche avec son parc ouvert à tous, ou au contaire les cinémas Saga et Klinkenberg dans le sens opposé; et un peu plus loin, dans le prolongement de la rue Olav V qui va vers la mer, le nouveau quartier commercial tendance Aker Brygge, autrefois chantier naval, aujourd´hui saturé de nombreux restaurants chic et de gargottes installées sur les quais, vendant des crevettes qui se tortillent encore. C´est la vie même, multicolore et chatoyante, où pratiquement toutes les langues se font entendre : thaï, urdu, polonais, kurde ou espagnol; sans parler de l´anglo-américain avec ou sans accent étranger.
Chacun croise l´autre sans vraiment le voir, mais sans l´ignorer non plus : des femmes seules et pressées au jean délavé et troué qui leur moule les fesses; d´autres, ni jeunes ni belles, passent aussi vite, le corsage entrouvert; certaines exhibent sans gêne le haut de leurs deux seins fermes que le soleil a bruni; d´autres, sans gêne non plus, beaucoup moins pressés que les précédentes, les montrent tout autant, bien que blancs et opulents; passent aussi des femmes moins jeunes, à l´âge indéfini, qui tiennent ferme leur sac sous un bras; également des retraitées, habillées de vêtements clairs démodés, qui s´avancent à pas comptés vers une destination qu´elles seules connaissent.
Rares sont les hommes en ce lundi après-midi, sinon un touriste américain tenant à la main un minuscule appareil de photos numériques, accompagné d´une femme qui lit un plan en marchant, et de deux enfants de 10 - 12 ans, le regard vide d´ennui.
Un homme seul allume sa cigarette.
Un homme jeune et bien mis, tenant à la main une femme presque aussi grande que lui, s´immobile soudain devant la vitrine de la boutique Narvesen. Ils s´embrassent avec fougue, à pleine bouche. Font mine de se quitter. S´embrassent à nouveau. Personne ne fait attention à eux. Ils s´embrassent encore. Puis se quittent aussi brusquement qu´ils avaient surgi, sans se retourner. L´homme, tout en marchant, sort alors de la poche de sa veste un portable qu´il porte à l´oreille. La femme, d´un pas aussi rapide que celui de l´homme , s´éloigne dans une direction opposée, mettant son sac sous le bras après avoir vérifié qu´il était bien fermé.
Un bruit infernal se fait alors entendre : celui de la scie d´un tailleur de pierres qui refait la chaussée et le trottoir de la rue Karl Johan.
Un homme au visage connu fait son entrée dans le Burns Pub. Je le dévisage. Il fait rouler derrière lui un petite valise noire. Il me regarde tandis qu´il me dépasse. Je cherche à savoir où j´ai bien pu le rencontrer. Il repasse près de moi, un petit verre de blanc bien frais à la main, tirant toujours derrière lui sa petite valise noire. Je cherche à nouveau à savoir où j´ai bien pu le voir. Lui aussi me dévisage, mais ses yeux sont impassibles. Il prend place à la table qui est juste à ma gauche. J´ose l´aborder. Il me répond sans sourciller qu´il passe souvent à la télévision. Son accent de la ville de Bodø, au Nord de la Norvège, me permet aussitôt de le reconnaître. Je précise que je connais assez bien cette ville. Il en vient, dit-il. Mais il n´est pas en veine de confidences. Il prend son portable, compose un numéro, boit une gorgée de son petit vin blanc bien frais et se lance dans une longue conversation qui ne me concerne pas. J´entends sans le vouloir les premiers mots : - "Je suis à Oslo, au Burns Pub" . Je tourne volontairement la tête dans une autre direction pour être sûr de ne pas entendre.
Des arbres rabougris et plantés volontairement près l´un de l´autre sur le trottoir un peu sur ma droite font de ce lieu de passage pour piétons un lieu interdit pour les voitures. La rue Olav V est donc à cet endroit comme une impasse. La chaussée proprement dite s´achève avant les arbres. Seuls les taxis ont droit de s´y engager pour tourner au pas et stationner en attente de clients, dans un emplacement qui leur est réservé, face au cinéma Klinkenberg et un autre café-institution, le Nichol & Son. Les chauffeurs ont rarement la tête blonde et les yeux bleus. Mais ils connaissent la ville d´Oslo mieux que personne. J´en ai fait l´expérience, une nuit de pleine lune en mai. C´est pas couscous béchamel ni cassoulet merguez mais kebab ketchup et sauce brune pizza
Le vent se lève. Des rafales plient les blanches des arbres rabougris. La lumière faiblit. Des cheveux s´ébouriffent. Une femme enceinte rajuste la capote d´une poussette dans laquelle somnole un enfant. La pluie se met tout-à-coup à tomber, drue, tambourinant le toit et les vitres du Burns Pub. Les passants se raréfient aussitôt. Certains, cependant, bravent et le vent et la pluie, mais ils sont comme emmitouflés de toiles déperlantes vert pomme luisant, rouge éclatant ou gris sale fripé. Les parapluies sont plus rares. Ceux ou celles qui les tiennent les ont abaissés au plus près de leur tête pour empêcher que le vent les retourne. Les gouttent perlent sur les toiles cirées jaunes.
La pluie s´apaise. Le vent aussi. Les passants reprennent leur ballet.
Un handicapé, dans sa chaise électrique.
Trois jeunes filles, très peu vêtues et trempées.
Un cadre au complet anthracite, le portable à l´oreille.
Deux femmes encore assez jeunes s´immobilent un instant. Elles se regardent, se sourient, s´embrassent sur la bouche. Et repartent, comme si de rien n´était.
Un homme bedonnant traine la jambe.
Un roller.
Une jeune handicapée, sans sourire, maniant difficillement son fauteuil roulant.
Deux touristes, arnachés d´énormes sacs à dos bleus, et sanglés de partout.
Une petite dame et son chien en laisse, à tout petits pas.
La pluie s´est arrêtée. Le vent, bien que moins violent, souffle toujours en rafales imprévisibles. Un timide rayon de soleil fait son apparition, éclairant faiblement la facade de l´immeuble d´en face. Mon voisin au dialecte du Nord parle toujours, sans que je sache s´il s´agit ou non de la même personne..
Il est un peu moins de 15 heures. Je range dans ma poche le calepin sur lequel j´ai écrit un plus de trois pages de notes.
Quatre vers du jeune Aragon me reviennent :
Je danse au milieu des miracles
Mille soleils peints sur le sol
Mille amis mille yeux ou monocles
m´illuminent de leurs regards
"Parti-pris" in Feu de Joie
(1920 - La Pléiade 2007)